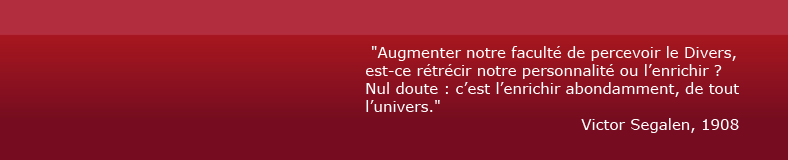Imprimer  |
|


Comment enseigner une langue maternelle… quand elle n’est plus langue maternelle ?
Posté par Colette Grinevald et Bénédicte Pivot le 17 décembre 2010
Colette Grinevald et Bénédicte Pivot sont linguistes au laboratoire Dynamique Du Langage (DDL) de l’Université Lyon 2.
http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/led-tdr/

carte_amcentrale
Quand la langue ethnique n’est pas langue maternelle mais une langue en danger à haute valeur symbolique identitaire pour sa communauté, quelle est sa place dans l’éducation formelle ?
L’UNESCO reconnait à chaque groupe ethnique des droits linguistiques qui favorisent le développement de programmes d’éducation bilingue. Ces programmes s’appuient sur les discours scientifiques qui ont montré que les apprentissages scolaires et le développement cognitif des enfants avaient de meilleurs résultats lorsque l’enseignement était dispensé dans leur langue maternelle (voir les articles de Tove Skutnabb-Kangas).
Mais, si les intentions sont bonnes, les discussions précédentes ont montré que ces programmes n’étaient pas faciles à mettre en place, même quand il y avait encore suffisamment de locuteurs.
Alors qu’en est-il quand en plus du manque de locuteurs la langue ethnique n’est plus une langue maternelle, au sens langue vernaculaire de premier apprentissage enfantin, mais reste néanmoins, aux yeux et au cœur de sa communauté « leur langue » et qu’à ce titre, ils veulent la revitaliser dans le cadre d’une éducation formelle ?
Les Ramas sont des Amérindiens du sud de la côte caribe du Nicaragua. Sur les quelques 3000 personnes qui composent la communauté rama, seule une trentaine d’entre eux sont encore locuteurs de leur langue ethnique. Ce qu’ils parlent aujourd’hui entre eux est une variante du créole à base anglaise qui a été implanté par la population créole dominante. L’espagnol, langue officielle du pays n’est pour eux qu’une deuxième langue que peu dominent vraiment.
Mais dans le contexte du mouvement de revendication identitaire indigène national et amérindien des années 80, et alors que cette langue, le rama, qu’ils appelaient eux-mêmes « langue de sauvage », tiger language, était en train de disparaître, les chefs de la communauté ont demandé qu’elle soit revitalisée. S’en est suivie une démarche de revalorisation qui a été accompagnée dès le début par une équipe de linguistes extérieurs.
Vingt-cinq ans plus tard, l’attitude des Ramas vis-à-vis de leur langue ethnique a changé : celle-ci est devenue un « bien » précieux dont ils sont fiers, dont ils disent qu’elle est leur « langue trésor ». C’est « leur langue », our language, celle qui leur appartient et qui fait d’eux des individus identifiables, différents des autres groupes ethniques et surtout différents des Créoles.
Ils aident ainsi à remplir le dictionnaire encyclopédique en ligne du rama (www.turkulka.net) et capitalisent « mot à mot » leurs savoirs linguistiques. Ils se sentent satisfaits d’avoir pu en apprendre quelque chose, répondant que « oui ils connaissent la langue, car ils speak one one word… »
Cette langue leur permet par ailleurs de revendiquer la souveraineté sur leur territoire (reconnu par la loi depuis 2009), dont ils ont re-appris les toponymes en rama.
Ainsi, le rama a changé de statut ; il est devenu une « langue trésor » à forte valeur symbolique identitaire et démonstrative, qui n’a pas vocation à être reparlée couramment un jour, qui n’est pas et ne sera probablement jamais plus une langue maternelle, à l’instar du zapara de l’Equateur (voir l’article d’Anne-Gaël Bilhaut). Mais, cette langue trésor n’en reste pas moins objet d’une demande de la part de la communauté pour sa revitalisation dans le cadre d’un programme éducatif formel, auprès des enfants scolarisés.
Or la seule réponse institutionnelle aujourd’hui, qui s’appuie sur les droits linguistiques internationaux, passe par des programmes d’éducation bilingue qui ne savent pas faire la distinction entre langue ethnique et langue maternelle. Il y a ainsi une absence de réflexion sur le statut particulier de ces langues en danger à forte valeur symbolique, qui deviennent objets de programmes de revitalisation sans avoir vocation à être re-vernacularisées. Leur transmission pose la question d’une didactique appropriée à leur enseignement, qui reste à inventer.
Si ce défi n’est pas abordé en face, il continuera à régner une grande confusion dans les esprits des acteurs locaux de la revitalisation et d’un système d’éducation qui se veut multicuturelle et bilingue (ou multilingue) mais ne reconnait pas ce statut spécial de langue trésor.